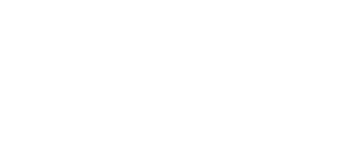Regards sur Khosro
PIERRE RECOMMENCÉE par Yadolla Royai

LES BÊTES DE LA NUIT par Paul Bélanger
Les bêtes imaginaires de Khosro Berahmandi veillent sur nous, tout en constituant la peau du tableau. Issues de la nuit, ainsi que d’incandescentes apparitions, elles hantent les rêves et, dans la dignité de leur distance, elles nous demandent de les accueillir pour les garder en pleine lumière.
Devant ces « créatures merveilleuses », le spectateur n’a d’autre choix que d’abandonner son regard à cette nouvelle vision. Il suit la minutie du peintre à donner chair à ce qui surgit de l’abîme, le noir étant un révélateur. Le peintre lui-même, dépositaire, bestiaire vivant de ce qui flotte dans les songes, autour de nous, est cet abîme où naît la vision. Car ici, le noir est le contraire d’un trou ou d’une aspiration, il est la possibilité d’un surgissement. Les bêtes, tout à coup, sont devant nous, comme des élans spirituels que leur animalité incarne, avec leurs lieux et leurs couleurs. Le peintre est le point focal qui permet une rencontre singulière, comme s’il était le médiateur de ces créatures avec le monde.
Tant de détails ne sont pas le fait d’ornements hasardeux, mais bien le témoignage d’une tradition picturale qui est le passage du monde physique au monde des « esprits ». Comme dans une allée où les images sont l’écho d’un mouvement invisible, il nous fait voir ces animaux diaphanes, venant d’un horizon sans perspective.
Dans leur amitié bienveillante, ils veillent sur nous.
Ainsi des mots des poètes qui répondent à l’amitié du peintre et de ses images.
Qu’elles veillent encore longtemps…
L'OEUVRE par Hossein Sharang
La version française suit
اثری که خود اوست
« و بینایی که پستان دیگر دانایی را دوشید، جمیع صورت ها از آن بر میآید. »
« اوپانیشاد »
و افکنده ای که از پستان آن مرغ دانا شیر سرد بینایی نوشید، گرم چهر و چهرآفرین میشود. چشم دلش « کودکی آینه به دست » است. حیران درون انسان و چهرستان پنهان در جهان. فر دست درست اش را فواره ی نقش و رنگ میخواهد. نقش و رنگ آنچه که انسان با دستکاری طبیعت در معرض انقراض قرار میدهد و چون وجودی زیادی از چرخه ی حیات به بیرون پرت میکند…تا خودش کی پرت شود.
خسرو برهمندی با چنین شمی به اغتشاش حیات چشم میگشاید و شگفت اینکه افسرده نمیشود و سر به برهوت پوچی نمیگذارد، بلکه پیوسته و مهربان، آخرین علایم نقش و رنگ باخته، دور انداخته و در آستانه ی انقراض را گرد هم میآورد و در این عصر جنون گاوی و مرگ و میر میلیونی پروانه ها و پرنده ها، افسوس بزرگ نگاه آخرین دایناسور به دنیا را، سنگ بنای شهری درونی در خانه و آتلیه ی خود میکند. خانه و کارگاه اش شهر « ماده گاو رنگارنگ میشود، جایی که کودک و حیوان خوف و خطر دیده در آن پناه میگیرند. کوه های زخمی میآسایند. به بادهای مسموم اکسیژن میرسد و از حیات مراقبت میشود.
هروقت و چه بسیار که به خانه ی خسرو میروم خود را در کتابی گمشده می یابم و گمشده ی خود را می یابم. انگار « ارژنگ » را ورق میزنم یا با صدایی درونی واپسین سرود مانی پوست کنده را میشنوم. درست در همان لحظاتی که انتظار دارم عمیقا افسرده میشوم. دلم قوت می گیرد و باطن ام از صفا و شادی گرم می شود.
درسیر و سلوک صاحب این اسم هندوایرانی شعاعی از لبخند « گوتاما » « گاث »، نیم شب « اسپیتمان » و سرود سپاس « مانی » هست و هستی اش خود اثری است والا که دوستان را به جشن و شادی میانگیزد.
و این حرف ها در برابر او، خنده ی ستایش ماراست.
و او زرافه ای در وجدان انسان است .
کندو- مونترال- حسین شرنگ
L’œuvre par Houssein Sharang, traduit par Bahman Sedighi
« Dès que la vision boit l’autre sein de la sagesse, l’ensemble des visages y émerge »
Les Upanisads
Et le déchu qui boit de l’autre sein, le lait froid de la vision, son visage deviendra ardent et gracile. L’œil de son cœur c’est « un enfant avec un miroir entre les mains ». Il fige le dedans de l’homme et le visageoir caché de l’univers. La grâce veut que sa main devienne le jaillissement de traces et de couleurs. Celles de ce que l’homme, en manipulant la nature, expose au renversement et les jette en dehors de la chaîne de la vie…jusqu’à ce qu’elles se jettent à leur tour.
Khosro Brahmandi avec une telle essence, ouvre les yeux sur le trouble du monde. Il est étonnant de constater qu’il n’est devenu ni mélancolique ni errant du désert futile. Au contraire, toujours gentil et cohérent ; il ramasse les dernières couleurs et signes pâles, jetés et fonde avec toutes ces récupérations et avec le grand répit du regard de dernier dinosaure, la pierre de sa cité intérieure, tout comme dans sa demeure que dans son atelier. Et cela dans une époque de la vache folle, de la mortalité des mille millions papillons et d’oiseaux. Sa demeure et son atelier deviennent la cité de la vache colorée, là où l’enfant et l’animal traqué prennent refuge. Les montagnes blessées, s’y reposent. Les vents toxiques, s’y oxygènent et la vie est surveillée. De temps à autre, ou souvent, lorsque je vais chez Khosro, je me vois dans un livre perdu et je me retrouve. Comme si, je feuilletais Arjang ou d’une voix intérieure, comme si j’entendais le dernier chant de Mani écorché. Mon cœur regagne du courage, mon intérieur se réchauffe de joie et d’amitié.
Dans la poétique de ce nom indo-iranien, on voit encore un rayon du sourire de « Gotama », de « Gath » de minuit, de « Spitman » et l’hymne de reconnaissance de Mani, et son existence est une œuvre, bien sûr que les amis s’en réjouissent. Et tous ces dits, c’est le sourire de l’admiration du serpent. Khosro, est le girafe de la conscience humaine.
L’OUBLI ET LE SILENCE par Bahman Sadighi
BBaL’oubli et le silence
Oblivion and Silence
Texte / text
Bahman Sadighi
Translation to English
Nina Gilbert
The English version follows the French text
La collection Arts Visuels
Maison d’édition Ketab Iran Canada Inc
Printemps 2010
L’infigurable
Il va sans dire que le rapport qui va de la face à l’in-façable, à l’absent, est en dehors de toute révélation ainsi que de toute dissimulation. Il y a certes une exclusion, une troisième voie exclue par ces contractions contradictoires. C’est ainsi que vient l’a-visage de la troisième personne. Ce IL, inexprimable irréversibilité, c’est-à-dire échapper à toute révélation comme à toute dissimulation, voilà l’infigurable, voilà l’art.
Dans une de ses lettres à Schuffenecker, Gauguin écrit : «[…]à savoir, d’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? C’est la voie de l’art ». Ceci m’amène aux œuvres de Khosro Berahmandi où il n’y a aucune tentative de réponse à cette question posée des milliers de fois par peintres, poètes, musiciens et penseurs, etc. Œuvrer dans l’art pour répondre à cette question sans réponse et sans intérêt est inutile, c’est un acte vain. Il ne faudrait pas limiter la peinture à la révélation ni à la dissimulation.
Khosro, tout comme Klee ou Morrisseau ou l’art sumérien, Da Silva, Braque, Miro, Dubuffet, Giacometti, Zao Wouki ou Chirico ou Bram Van Veld, Pellan, etc., libère la peinture du domaine irrespirable et très étroit où elle végétait et lui donne un grand espace. Ce que j’aime dans ses œuvres, c’est la présence tacite et sensible d’un travail appliqué, fragile, méticuleux, patient, serein et amoureux d’un tisserand, en un mot, c’est un travail d’alchimiste.
À quoi bon rapporter dans une œuvre le connu ou ce que l’on connaît tout aussi bien sans l’œuvre. Une certaine grâce scintille dans les œuvres de Khosro, toujours réservé et curieux quand il s’agit de l’art, notamment la poésie et la peinture. L’œuvre est donc éclairée par le concept d’alchimiste, mais une alchimie qui trouve sa vérité dans l’alchimie de l’œuvre. Il serait injuste de réduire les œuvres de Khosro à une culture ou une révélation dominée ou dominante, car son souci ne relève pas de culture, de revendication; son seul souci est le tissage de l’œuvre. Il n’a pas l’intention de rendre le visible, ni visible ni invisible. La révélation ou la dissimulation ne l’intéresse pas. Il est dans la troisième voie. La voie d’IL. Ses œuvres sont la poursuite inlassable de chaînes et trames qui se tissent nœud par nœud. C’est l’œuvre, c’est la texture, la patience, l’alchimie de l’œuvre, peu importe; ce sont sa culture et son message.
Ni homme, ni animal, ni botanique ne ressemblent aux divinités ou aux faces que Khosro peint. Toutefois, à la vue de ses tableaux, quelque chose s’interroge au plus profond de nous. Cela ne signifie pas que cet effet vient d’un passé lointain ou à venir. Ces figures, ces divinités, il va les chercher au fond de lui-même et non pas d’un rituel local, culturel et cérémonial. Il serait très difficile de réduire ses œuvres au chamanisme, totémisme ou aux miniatures. Ce serait bien dommage!
Cette vie, ni quelques dieux ni quelques hommes ne l’ont créée. De nature, elle est foudre et le restera toujours avec mesure. Elle s’allume, elle s’éteint; ceci est l’œuvre. Ceci est le tissage. Ceci est l’œuvre, car elle naît d’une expérience qui ne la précède ni ne la devance, c’est une expérience pure. C’est du feutré. Et elle naît lorsque le peintre se met à composer son œuvre sans aucun modèle ni identique à un monde réel, vrai ou faux. L’œuvre ne peut être empruntée à notre petite vie, à notre vie d’homme; elle se rapporte plutôt à l’expérience de l’œuvre et cette expérience ne peut se commencer que par l’œuvre elle-même.
L’originalité de Khosro s’explique par cette expérience pure qui n’apporte aucun antécédent ou post-étant. Et l’originalité d’une telle œuvre est qu’elle est toujours nouvelle. Khosro, comme bien des peintres, est le libérateur de la peinture des sujets bornés. Dans la plupart de ses œuvres, le sacré est à l’image de l’homme ou d’une plante ou d’un animal. Mais pourquoi cette apparence de ressemblance du sacré avec l’humain? Avec le visage? Comme disait Brion : « Le sacré, comme quelque chose de tout autre», selon la définition de R. Otto (cette forme d’art) « tout en conservant la figure humaine ou animale, car elle ne peut penser Dieu que sous la forme d’un homme […]se dit que le divin ne peut être banalement humain ou animal et s’efforce naïvement ou subtilement, par une stylisation appropriée, de traduire ce sentiment de tout autre.». Ainsi, les traits extraordinaires de ces êtres qui peuplent les toiles de Khosro ne peuvent pas être que ceux de l’homme. Voilà le souci de Khosro : créer une figure qui soit autre chose que ce qu’elle représente. Quelle personne ressemblerait au dieu Abu sumérien, ou aux sculptures de Giacometti ou encore aux masques africains ou bien à l’autoface de Khosro?
Alors si les œuvres de Khosro ne sont pas figuratives, dans ce cas, il vaudrait mieux parler de l’art non figurable que d’art abstrait. Il ne s’agit pas de copier le monde, mais de le manifester, cet infigurable qui n’est perçu par aucun organe des sens. Ainsi, l’œuvre qui se soucie d’elle-même ne pourra être figurative; dans un certain sens, elle est non-figurative pour ne pas dire abstraite, car tout abstrait n’est pas forcément abstrait ou non-figuratif. Peut-être que la meilleure appellation pour les œuvres de Khosro serait de l’art impersonnel. L’art où l’homme est absent. Ainsi l’art ne serait pas un ensemble de symboles ou de formes et de signes inventés par l’homme. Les symboles que Khosro utilise sont les symboles de l’œuvre, du tissage, d’instant en instant; c’est la progression de l’œuvre même et non pas le visage atteint.
Certes, dans les œuvres de Khosro, on a le sentiment d’une temporalité, à savoir que ses œuvres donnent le sentiment de quelque chose qui a traversé la couleur, le mot, le temps qui, dans cette traversée, a été poli, lustré, feutré et ainsi ses œuvres sont pourtant frustres et comme prégnantes d’une sagesse et d’un sacré presque immémorial; le lointain temporel, l’infigurable. Parmi les œuvres de Khosro, voici une liste d’œuvres dont les titres poétiques conviennent parfaitement à ce que nous avançons :
Les racines du cosmos
Le couple non-humain
L’abysse de la lune
Dans le miroir d’une nuit d’été
Grain de beauté
Raison ocre
Érospirituel
L’œil renversé
L’éléphant
L’ombre du papillon
Torche moussue
Horizon parfumé
Geste de vague
Auto face : resurgir
Auto corps : surgir
Charge du miroir
L’art qui se limite à représenter cette vie extérieure est inadéquat. À vrai dire, l’œuvre de Khosro ne s’arrête pas au sensible. Son œuvre puise la culture de l’œuvre et non celle d’un peuple ou d’une tradition pétrifiée ou tissée. Cette appartenance est la même que le regard tourné vers le premier taureau que l’homme gravait avec son art et son moyen d’abstrait. Ces toiles appartiennent à toutes les cultures, en l’occurrence à aucune culture, elles sont le lointain tissé. Son œuvre est la rencontre de toutes les civilisations où l’homme se traduit par ses croyances, ses folies, son sensualisme. Et ceci a quelque chose avec le plus profond de soi et de l’homme, pour ne pas dire primitif.
Il ne peint pas d’après la nature ou l’homme. L’art est une abstraction. Il faudrait le sortir de l’homme et de la nature, il n’a pas été donné, il est à créer, à tisser, à mourir. Il faudrait penser plus à la création qu’au modèle, qu’à l’homme. Voilà la peinture de Khosro. Il crée sa propre mythologie non pas pour donner un sens à la vie ou à la mort, elle est mythique, elle ne relève pas de l’Histoire, elle est avant, l’Avant-Histoire. Toutefois, elle n’a aucun rapport avec un monde ancien pas plus qu’avec celui d’un présent ni d’un quelconque futur. C’est une mythologie qui ne précède ni l’homme, ni sa culture visuelle, ni son histoire, ni l’Histoire; dans les œuvres de Khosro, il n’y a aucune histoire. Il crée son propre style abstrait pour exprimer le sacré de sa propre mythologie. C’est l’art de la profondeur qui séduit et émeut. Ses demi-dieux, ses créatures de la forêt, loin de représenter un chamanisme ou une initiation, vivent avec beaucoup de force et de volonté et d’existence, d’une verticalité souvent osseuse et squelettique et épurée. Certes, Khosro ne cherche pas à être identifié par son totem personnel. Son totem ou ses totems servent d’emblème à sa relation mystique avec l’art et non à celle d’un groupe de gens.
Que ces totems soient, taureau, dragon, serpent, éléphant, papillon, loup ou girafe etc., oui, mais ce sont des symboles qui se trouvent aujourd’hui encore à travers le monde. Leur différence, c’est qu’ils sont intériorisés, alchimisés. La force et la présence pleine de ces totems viennent de l’unicité des teintes utilisées. Il ne mélange presque pas les teintes et préfère les mettre telles qu’elles sont. La couleur chez lui est un peu comme l’astral de l’âme, elle est unie, sereine et solide. L’art que Khosro cherche n’est ni figuratif ni révélation de cet autre monde, car l’inconnu, le sacré, ne peut devenir figure ou figurable, car jamais l’inconnu ou l’infigurable n’appartiendra à ce qui se montre, aucune œuvre, aucune pierre, etc., ne pourra jamais être identifiée à lui, cet inconnu tant cherché.
Certes, c’est l’infigurable, l’informulable qui est à l’origine de toute recherche d’une manifestation de sacré. Ainsi, nous pouvons dire que les peintures de Khosro ou encore de Morrisseau ou de Piero della Francesca sont la forme même du sacré, de ce lointain impersonnel. Peut-être peut-on ajouter que l’œuvre est comme son extérieur; un dehors, par lequel en même temps nous sommes liés et repoussés. Même si les œuvres (les êtres) de Khosro sont chargées de l’énergie du sacré, on ne peut les considérer ni comme des dieux ni comme le sacré lui-même, mais seulement comme le reflet de ce sacré. En réalité, ses œuvres sont un lieu d’extrême vacances où Il ou le sacré peut apparaître, ses personnages sont attentifs à un événement qui n’a pas encore eu lieu, d’où ce sentiment de quelque chose de très matinal.
Les personnages de Khosro ou de l’art sumérien font face à cela. On a souvent le sentiment que les personnages sont du même côté que lui, on ne le voit certes pas directement, mais Il est derrière leur regard. J’admire l’alchimie parce que dans ce cas-ci, l’œuvre n’est pas seulement la forme du sacré, elle est elle-même sacrée. Je suis d’accord avec Bonnefoy que « l’art vraiment moderne est de vouloir fonder une vie divine sans Dieu.» ou encore avec Jacottet que « Le sacré est ce quelque chose qui a été appelé « Dieu » depuis toujours.». Il me semble qu’à l’intérieur des œuvres de Khosro, il existe un certain sentiment même une adoration, certes spécifique, qui n’est pas une prière, car elle ne s’adresse pas à un dieu quelconque mais à l’infigurable, à la chose séparée. La caractéristique de ce sacré est sa sobriété et sa sévérité. Cette sobriété et sévérité que l’on trouve aussi dans certains visages de divinité de Khosro. Dans un certain sens, nous pouvons dire que la seule manifestation du sacré passe par l’art, car l’art authentique est un art sobre et sévère. L’art n’a pas toujours été tout autre chose que ce qu’il est le plus souvent devenu. Peut-être comme disait Malraux : « il faudrait renoncer à l’art en tant que tel.», ou encore comme disait Hegel : « l’art est mort.». Ceci est aveugle et radical. L’art n’est pas mort, car le sacré vit encore et c’est ainsi qu’il se manifeste. Il faudrait peut-être se dire qu’il y a eu, qu’il y a encore une toute autre fonction de l’art. Du temps de Sumer jusqu’à nous ou Khosro, celui qui fait une œuvre n’a pour but ni de plaire à un amateur, ni d’imiter la nature, ni l’homme, ni Dieu, ni de s’exprimer en tant qu’un individu ou un groupe, ni de construire une belle forme, ni de composer une belle couleur, mais de manifester une certaine relation de l’œuvre avec le divin de l’œuvre, l’œuvre elle-même. L’œuvre est l’un des modes mystiques, mais certes, le plus pur, car elle est impersonnelle. L’œuvre était seulement cela, est cela et demeurera cela : sacrée et jamais profane. L’artiste et la prière ne s’adressent plus au monothéisme ou au paganisme, la prière s’adresse au plus profond, au plus Étranger et plus Inconnu de l’œuvre. La parole du chant qui plane dans les œuvres de Khosro n’est plus un hymne à quelque chose ni aux peintres, pas davantage hymne à la nature ou à n’importe quelle forme d’animisme, mais bien l’hymne de l’œuvre du sacré. L’œuvre est l’avènement du sacré. L’œuvre appartient donc au sacré, mais à un sacré sobre, sévère : elle est annoncée plutôt qu’elle n’existe déjà. Ce sacré, c’est l’éloignement d’un certain sacré disons de la théophanie, mais cet éloignement rapproche d’une œuvre sobre, la plus haute du sacré. S’éloignant du Dieu-Être, et surtout du Dieu-Roi, Khosro s’approche d’un Étranger, de l’infigurable : de l’œuvre.
Bahman Sedighi
The Unfigurable
It can be said that the relationship between the faced and the un-faceable, the absent, is beyond all revelation, as well as all dissimulation. Yet, there is certainly a third path, excluded by these contradictory contractions. Thus is en-visaged the advent of the third person impersonal, the IT, inexpressible irreversibility which escapes all revelation and all dissimulation, – this is the unfigurable, this is art.
In one of his letters to Schuffenecker, Gauguin writes: “[…] to discover, where we come from. What we are. Where we are going. This is the path of art. » This brings me to the artwork of Khosro Berahmandi which makes no attempt to answer this question, posed thousands of times by painters, poets, musicians, thinkers, etc. Labouring through art to answer this question without answer and without interest is futile, a vain act. Painting should not be limited to either revelation or dissimulation.
Khosro, like Klee or Morrisseau or Sumerian art, or like Da Silva, Braque, Miro, Dubuffet, Giacometti, Zao Wouki, Chirico, Bram Van Veld, Pellan, etc., liberates painting from the suffocating and narrow field in which it has been stagnating and opens a wide space for it. What I love about his artwork is the tacit and tangible presence of the applied, delicate, meticulous, patient, serene and loving work of a weaver; in a word, it is the work of an alchemist.
What good is it to reveal the known in a work of art, or what we know just as well without artwork? A form of grace scintillates in Khosro’s artwork, and he is always reserved and curious when it comes to art and, in particular, to poetry and painting. Khosro’s work is thus illuminated by the concept of the alchemist, but the truth of this alchemy lies in the alchemy of the work of art. It would be unjust to reduce Khosro’s artwork to a dominant culture or revelation, for his concern is not with culture or with revindication; his sole concern is with weaving the work of art. His intent is neither to reveal nor to conceal the visible. Neither revelation nor dissimulation interests him. His is the third path. The path of IT. His artwork is the tireless pursuit of the warp and weft, woven thread by thread. It is the work of art, – the texture, the patience, the alchemy of the work of art – this is his culture and his message.
Neither man, nor animal, nor plant resembles the divinities or faces that Khosro paints. And yet, looking at his paintings, we feel something deep within us being addressed. This effect does not derive from any reference to a long ago or a still to come. He finds these figures, these divinities, deep within himself and not in a local, cultural or ceremonial ritual. It would be very difficult to reduce this artwork to shamanism, totemism or miniatures. And it would truly be a shame to do so!
Neither a scattering of gods nor of humans created this life. It is of the nature of lightening and will always, to some degree, remain so. It flares up, it is extinguished: this is the work of art. This is the weaving. This is the work of art, for it is born of an experience that neither precedes nor overtakes it; it is pure experience. It is felt-like. And it comes into being when the painter sets out to compose his work without any model drawn from a real world, either true or false. The work of art cannot be borrowed from our everyday life, our human life; it belongs rather to the experience of the work of art and this experience can only derive from the work itself.
Khosro’s originality derives from pure experience which carries with it no beforehand or afterwards. And the originality of such artwork is that it is always new. Khosro, like many painters, is the liberator of painting from bounded subjects. In most of his work, the sacred appears in human, plant or animal form. But why this apparent resemblance of the sacred to the human? To the face? Brion wrote of the sacred “as something completely other,” and according to the definition of R. Otto, this form of art “while retaining the human or animal form, for it cannot conceive of God other than in human form […] acknowledges that the divine cannot be banally human or animal and attempts naively or subtly, through appropriate stylization, to translate this feeling of something completely other.” Thus, the extraordinary features of the beings that populate Khosro’s canvases cannot be other than human. Khosro’s concern is this: to create a figure that is something other than what it represents. What person looks like the Sumerian god Abu, the sculptures of Giacometti, like African masks or, again, like Khosro’s autoface?
So, Khosro’s artwork is not figurative, yet in this case, it would make more sense to speak of non-figurable art than of abstract art. It is not about copying the world, but about making manifest the unfigurable that cannot be perceived by any sensory organ. Thus, the work of art, whose concern is itself, cannot be figurative; it can be termed non-figurative, not to say abstract, for not all abstract art is necessarily non-figurative. Perhaps
Khosro’s artwork could best be labelled impersonal art: art from which the human is absent. Such art would not be an arrangement of symbols or of shapes and signs invented by humans. The symbols that Khosro uses are symbols of the work of art, of weaving, of the moment-to-moment, indicating the progression of the work of art itself and not a symbolic figure.
Certainly, in Khosro’s artwork, one feels the traces of time, that is, his work invokes the feeling of something that has traversed colour, words, and time, and that in this crossing has been polished, shined, felted – and yet his artwork evokes a frustration, and is seemingly pregnant with an almost ageless wisdom and sacredness – of far-off time, of the unfigurable. Below is a list of some of Khosro’s works whose poetic titles perfectly express this view:
Elders of the cosmos
The non-human couple
The moon’s abyss
In the mirror of a summer night
Beauty mark
Ocre reason
Erospiritual
The reversed eye
The elephant
The butterfly’s shadow
Mossy torch
Perfumed horizon
Wave gesture
Autoface: resurface
Autobody: surface
Mirror’s load
Art that limits itself to representing life’s exterior is inadequate. In truth, Khosro’s artwork goes beyond the perceptible. His work draws on the culture of the work of art and not on that of a people or of a petrified or stitched-together culture. This work is at one with the gaze turned toward the first bull that humans etched with their art and their means of abstraction. These canvasses belong to all cultures, and thus to no culture, they are woven of the far-off. His work is the meeting of all civilizations where humanity reveals itself through its beliefs, its madness, its sensualism. And this is connected to our deepest selves, to the primally human, not to use the term primitive.
He does not paint from nature or from human beings. Art is an abstraction. It must be removed from humans and from nature; it is not given, it is to be created, to be woven, to die. One must think more in terms of creation than of a model, than of humanity. This, then, is Khosro’s artwork. He creates his own mythology, but this is not to make sense of life or death; his creation is mythical, it is not Historical, it is that which comes before, the Before-History. However, it is not related to an ancient world, no more than to the present or to a given future. It is a mythology that precedes neither humanity, nor its visual culture, nor its history, nor History; in Khosro’s work there is no history. He creates his own abstract style to express the sacredness of his own mythology. It is the art of depth, which seduces and moves. His demi-gods, his forest creatures, far from representing a shamanism or an initiation, are strongly imbued with life and will and existence and with a verticality that is often bonelike and skeletal and purified. Of course, Khosro is not trying to identify with a personal totem. His totem or totems are emblematic of his mystical relationship with art and not with a group of people.
These totems may be bull, dragon, serpent, elephant, butterfly, wolf, giraffe, etc., yes, but these are symbols that are still found today throughout the world. The difference is that, here, they are internalized, alchemized. The full, strong presence of these totems comes from the purity of the colours used. Khosro hardly mixes colours, preferring to paint them as they are. Colour, for him, is akin to the aura of the soul, – it is unified, serene and solid. The art that Khosro seeks to create is neither figurative nor revelatory of a world beyond, for the unknown, the sacred, cannot be depicted, – the unknown, or the unfigurable, will never be a part of that which is shown; no work of art, no stone, etc. can ever be identified with it, this ever sought after unknown.
Of course, it is the unfigurable, the inexpressible, that is behind all attempts to make manifest the sacred. Thus, we can say that Khosro’s paintings and those of Morrisseau or of Piero della Francesca are given form by the sacred, by this impersonal far-off. Perhaps, we could add that the work of art is akin to its exterior; an outside, which we are at once tied to and barred from. Even though Khosro’s works (his beings) are infused with the energy of the sacred, they cannot be viewed as gods, but only as the reflection of the sacred. In reality, his works of art are a place of extreme vacancy where IT, or the sacred, could appear; his beings evoke attentiveness to an event that has yet to occur, from whence the feeling of something very matinal.
Khosro’s figures and those of Sumerian art engage this sacredness. One often feels that the figures are on the same side as IT, although we definitely do not see IT directly, IT is behind their gaze. I admire such alchemy because, in this case, the work of art is not only given form by the sacred, it is itself sacred. I agree with Bonnefoy that “truly modern art seeks to establish divine life without God,” or again with Jacottet that “the sacred is that something that has always been called God.” It seems to me that Khosro’s work expresses a certain feeling, an adoration, that is definitely specific and that is not a prayer because it is not addressed to any god, but to the unfigurable, to that which is separate. This sacredness can be characterized as sober and severe. And sobriety and severity are apparent in some of Khosro’s faces of the divine. One could say that, in a sense, the only manifestation of the sacred comes through art, authentic art. For although art, in general, has become something completely other than itself, this has not always been the case. Perhaps, as Malraux claimed, “art as such must be renounced,” or again, as Hegel said, “art is dead.” But this is a blind and radical assertion. Art is not dead, for the sacred still lives and it manifests itself through art. One should perhaps say that art has had and still has a completely different function than the one it generally fulfills. From Sumerian times to now, or to Khosro, the goal of whoever creates a work of art is neither to please an amateur, nor to imitate nature, humanity, or God, nor to express themselves either as an individual or as a group, nor to produce a beautiful form or a beautiful colour, but rather to manifest a certain relationship between the work of art and its divinity, the work of art itself. Art is just one expression of the mystical, but certainly it is the purest, for it is impersonal. The work of art has been, is, and will remain only this: sacred and never profane. The artist and prayer no longer address monotheism or paganism, rather prayer addresses that which is deepest, most foreign and most unknown in the work of art. The song that hovers in Khosro’s artwork is no longer a hymn to something or to painters, no more than it is a hymn to nature or to any form of animism. Rather, it is the hymn of the work of the sacred. The work of art is the advent of the sacred. The work thus belongs to the realm of the sacred. Sober and severe, the sacred is not pre-existent, rather it is announced. This sacredness draws away from a certain sacredness associated with theophany, and moves toward a sober work of art, the highest form of the sacred. In drawing away from the God-as-Being, and especially from the God-as- King, Khosro moves closer to the foreign, to the unfigurable: to the work of art.
Bahman Sedighi
Un entretien entre Paul Belanger et Khosro Berahmandi
English translation follows
Juin 2011, Montréal
- Pourrais-tu résumer ta démarche de 20 dernières années ?
J’ai découvert le potentiel du pinceau, il y a vingt-cinq ans, ce qui représente un peu moins que la moitié de ma vie. C’était après ma fuite de l’Iran. À cette époque, c’était un pays gravement meurtri par la révolution et par une guerre violente au cours de laquelle de nombreux actes de vengeance absurdes et sanglants étaient commis régulièrement. Après une période trouble et pleine de tragédies bouleversantes, tourmenté par l’effondrement de mes idéaux et la perte de mes amis, jeune homme offensé que j’étais à l’époque, j’ai décidé d’aller vers l’inconnu. C’est durant cette période que le pinceau m’est apparu comme une sorte de poignée grâce à laquelle je pouvais m’accrocher au monde. Il semblait m’offrir une possibilité de vie, qui me permettait d’associer une sorte de sentiment divin à l’idée de la peinture. Ainsi, après avoir adopté le pinceau, j’ai eu la possibilité de trouver un nouvel idéal personnel, celui de la peinture. Et l’inconnu est devenu la surface sur laquelle j’ai commencé à peindre.
Au début, j’expérimentais la peinture abstraite et expressive en peignant de grandes toiles chargées d’émotions divergentes. Parfois une figure s’y immisçait subrepticement, mais uniquement pour soutenir le poids expressif du tableau. Je dois dire que mon travail artistique de cette époque était une cure contre moi-même, une forme de thérapie susceptible de donner un sens à ma vie et de constituer mon propre espace. À vrai dire, durant cette période, j’étais encore trop agité par l’idée de l’art, et, par conséquent, je m’éparpillais souvent. En cherchant à connaître mes capacités et les possibilités offertes par la peinture, je me perdais fréquemment dans le travail d’autres artistes. Par moment, j’avais l’impression que les œuvres des grands maîtres m’avalaient littéralement. C’est durant cette période également que j’ai pratiqué plusieurs formes d’expressions artistiques, car mon côté offensé cherchait à envahir et à explorer toutes les formes possibles de l’art. Ainsi, j’ai touché à la sculpture, à la photographie, à l’installation et surtout à l’art de la performance. Souvent, mon propre corps devenait la traverse que j’utilisais pour faciliter l’émergence de l’expression qui m’habitait.
C’était également une époque d’apprentissage universitaire durant laquelle j’ai été considérablement influencé par la pratique contemporaine qui gouvernait le milieu artistique des pays occidentaux. Peu après, j’ai pu cependant constater que ce milieu artistique jouait souvent un rôle de médium dont le devoir était d’expliquer l’actualité quotidienne et de permettre de s’y positionner. Ce faisant, il réduisait alors l’art à un outil dont les ramifications effleurent la surface de la réalité, et qui ignore le vaste territoire de la découverte.
De cette période, qui a duré environ une dizaine d’années, je n’ai conservé aucune œuvre. Je les ai toutes détruites au moment d’entrer dans une nouvelle voie, celle qui m’a permis de saisir une autre vision de la vie, autrement dit celle qui réunit le peintre et l’univers sur la même surface. C’est ça, la dimension noble de la vie et de l’œuvre. Je crois d’ailleurs que l’art a toujours été une ombre vaste et nébuleuse. Elle est née ici, mais elle est d’ailleurs. Ma démarche artistique de cette deuxième période suit donc cette pensée qui a pour but de mener vers un ailleurs où elle peut atteindre l’insaisissable. À cette fin, mon engagement pictural se traduit par la création de toiles sur lesquelles je peux offrir un habitat à cette épreuve tout en me projetant au dehors de moi-même. Ce mélange du moi, de la surface et du dehors a provoqué quinze ans de vertige sur le côté invisible de l’image où mes yeux touchaient le noir. Et après toutes ces années mouvementées, j’ai appris à voir dans la chair de l’univers; je suis devenu ses racines au travers de mon œuvre.
- Comment en es-tu arrivé à ce que j’appelle « le bestiaire des bêtes imaginaires » ? D’où viennent ces bêtes, que représentent-elles ?
Je ne suis pas arrivé au bestiaire des bêtes imaginaires, je suis devenu le bestiaire vivant. Je suis devenu taciturne, habité par les bêtes vivantes qui portent l’univers, ou bien qui permettent à l’univers de se condenser en elles. Elles observent l’espace qui les enveloppe et souvent elles expriment leur hébétude. Ces êtres errent. Ils ne nous appartiennent pas. Ils arrivent d’un ailleurs où l’horizon est déversé. Ces bêtes ne racontent ni n’expliquent. Elles se contentent de manifester leur gueule. Ces êtres sont la chaîne, la trame, l’essence de l’existence qui habite mon œuvre. Elles sont la peinture même.
Ainsi, il y a 29 ans, tout au début de ma vie à London, en Ontario, une professeure d’anglais, Mme Love, par une belle journée de printemps, nous a emmenés visiter le grand Zoo de Toronto. Au milieu de cette visite, explorant avec étonnement la diversité des animaux, après m’être écarté des autres élèves, je me suis retrouvé soudainement en face d’une girafe gigantesque qui venait de baisser la tête pour me regarder dans les yeux. Un échange de regards de quelques secondes a eu lieu. Oubliant de respirer, j’ai regardé droit dans ses yeux humides. Dès qu’elle a tourné la tête, mes yeux ont traversé avec précision son corps et j’ai rougi…
Neuf ans plus tard, cette fois-ci à Paris, après une journée sympathique de babysitting avec mon cher ami Pierrot qui, à l’époque, avait trois ans, un samedi estival, en fin d’après-midi, je me suis arrêté dans un bar. Là, pendant que je buvais tranquillement une bière en solitaire, un étranger s’est tourné vers moi en déclarant soudainement que, parmi tous les animaux de la terre, il n’y a que les girafes qui n’ont pas de voix et qu’elles sont également les seules à pleurer. Puis il m’a tourné le dos afin de continuer à boire son verre. En revenant chez moi, j’ai plongé dans mes mémoires et, peu à peu, la girafe qui m’avait fait rougir à Toronto a commencé à apparaître…
Trois ans après cet incident, j’ai gardé un autre enfant-ami voyageur de quatre ans qui vivait avec sa mère, elle aussi une bonne amie à moi, à Montréal. Quand le temps de leur départ est venu, mon petit copain Aaron m’a demandé de lui dessiner quelque chose en souvenir. Et c’est exactement à ce moment-là que j’ai accouché de mon bestiaire : une girafe qui regarde l’avion d’Aaron se perdre dans les cieux… Cette girafe était celle qui avait planté dans mes yeux la graine d’une idée noble. Une graine qui croît depuis ce temps où je l’ai regardée. Elle est maintenant l’extension de mes mains, elle revêt la forme d’une parole sombre et vaste à l’instar de l’idée de la girafe elle-même. La girafe pour moi est une idée noble qui s’allonge sur son côté vaste vers l’horizon où le vent rafale dans ses yeux humides. Sa présence assure mon avenir.
Plus tard, quand mon fils Vincent est né, il est devenu pour moi le gardien de ces animaux imaginaires et son regard sur mon œuvre a confirmé le bien-fondé de leur existence dans ma vie…
- Depuis l’Iran jusqu’à Montréal : un résumé
C’est l’histoire d’une ligne que j’ai tirée et que je tire encore. Celle qui est devenue une artère. C’est également une histoire de passage d’une aventure vers un silence pictural où je me projette vers un espace sans fin dans lequel je peux inventer celui qui m’habite. Ici, l’état de la bête épatée s’exode du noir du cosmos afin de dépasser les frontières de la surface pour rejoindre le fond des veines de la terre. Mon œuvre est un éternel déplacement vers la bête humaine et l’humain de la bête.
- Le noir qui couvre tes toiles semble peu à peu disparaître, au profit d’un développement du bestiaire : qu’est-ce qui se développe ? Le cadre s’élargit-il ?
Chez moi, le noir ne couvre pas la toile, il la devient. Autrement dit, le noir est l’état de mon œuvre. C’est dans le noir que je cherche à voir, et ce que vous voyez, c’est l’état des choses que je vois. Ce que tu appelles le cadre, c’est en effet l’environnement de l’image, ou bien de son habitat. L’image vit son propre corps. Puisque le noir est l’état de mon œuvre, il ne disparaît pas, il est le tableau même. La disparation du noir vue dans ma dernière série est liée à la croissance de l’image et à son environnement. En effet, c’est bien l’image ou ce que tu appelles le bestiaire qui a couvert le noir. Dans le noir, je noircis, et le noir s’enflamme. Et les trames dorées avancent pour s’échapper de l’espace obscur. Noir est l’horizon de mon œuvre et de mon être.
English translation:
An interview between Paul Belanger and Khosro Berahmandi
June 2011, Montreal
- Could you summarize your approach of the last 20 years?
I discovered the potential of the brush twenty-five years ago, which is a little less than half of my life. It was after I fled Iran. At that time, it was a country severely damaged by revolution and by violent war in which many absurd and bloody acts of revenge were regularly committed. After a troubled time, full of overwhelming tragedy, tormented by the collapse of my ideals and the loss of my friends, an offended young man that I was at the time, I decided to go towards the unknown. It was during this time that the brush appeared to me as a kind of grip with which I could hold onto the world. It seemed to offer me a possibility of life, which would allow me to accord a kind of divine feeling to the idea of the painting. So, after adopting the brush, I had the opportunity to find a new personal ideal, that of painting. And the unknown became the surface on which I began to paint.
At first, I experimented with abstract and expressive painting by painting large canvases loaded with divergent emotions. Sometimes a figure intruded on it surreptitiously, but only to support the expressive weight of the painting. I must say that my artistic work at that time was a cure against myself, a form of therapy that could give meaning to my life and constitute my own space. In fact, during this period, I was still too restless with the idea of art, and as a result, I was often scattered. In seeking to understand my abilities and the possibilities offered by painting, I frequently got lost in the work of other artists. At times, I had the impression that the works of the great masters literally swallowed me up. It was also during this period that I practiced many forms of artistic expression, as my offended side sought to invade and explore all possible forms of art. Thus, I have dabbled in sculpture, photography, installation and especially the art of performance. Often, my own body became the crossbar that I used to facilitate the emergence of the expression within me.
It was also a time of academic learning during which I was greatly influenced by the contemporary practice that governed the arts community in Western countries. Shortly afterwards, however, I was able to observe that this artistic milieu often played the role of a medium whose duty was to explain daily current affairs and to position oneself in it. In doing so, he it reduced art to a tool whose ramifications skim the surface of reality, and which ignores the vast territory of discovery.
From this period, which lasted about ten years, I have not kept any work. I destroyed them all as I entered a new path, the one that allowed me to grasp another vision of life, in other words one that brings together the painter and the universe on the same surface. This is the noble dimension of life and work. I also believe that art has always been a vast and nebulous shadow. She was born here, but she is from elsewhere. My artistic approach of this second period therefore follows this thought which aims to lead to an elsewhere where it can reach the elusive. To this end, my pictorial commitment is reflected in the creation of canvases on which I can offer a habitat to this ordeal while projecting myself outside of myself. This mixture of the ego, the surface and the outside caused fifteen years of vertigo on the invisible side of the image where my eyes touched the black. And after all these hectic years, I have learned to see into the flesh of the universe; I have become its roots through my work.
- How did you come to what I call « the bestiary of imaginary beasts »? Where do these beasts come from, what do they represent?
I did not arrive at the bestiary of imaginary beasts; I became the living bestiary. I have become taciturn, inhabited by living beasts that carry the universe, or that allow the universe to condense into them. They observe the space that surrounds them and often they express their stupor. These beings roam. They do not belong to us. They come from somewhere else where the horizon is poured out. These beasts neither tell nor explain. They are content to show their mouths. These beings are the warp, the weft, the essence of the existence that inhabits my work. They are painting itself.
So, 29 years ago, at the very beginning of my life in London, Ontario, an English teacher, Mrs. Love, on a beautiful spring day, took us to visit the great Toronto Zoo. In the middle of this visit, exploring in amazement the diversity of animals, after stepping aside from the other students, I suddenly found myself in front of a gigantic giraffe that had just lowered its head to look me in the eyes. A glance of a few seconds took place. Forgetting to breathe, I looked straight into her wet eyes. As soon as she turned her head, my eyes moved precisely through her body, and I blushed…
Nine years later, this time in Paris, after a pleasant day of babysitting with my dear friend Pierrot who, at the time, was three years old, on a summer Saturday, at the end of the afternoon prior heading home, I stopped in a bar. There, while I was quietly drinking a beer on my own, a stranger turned to me, suddenly declaring that among all the animals on earth there are only giraffes that have no voice and that ‘they are also the only ones to cry. Then he turned his back on me to continue drinking his drink. Coming home, I delved into my memories and, little by little, the giraffe that made me blush in Toronto began to appear…
Three years after this incident, I babysat another four-year-old traveling child-friend who lived with his mother, also a good friend of mine, in Montreal. When the time to leave came, my friend Aaron asked me to draw him something as a keepsake. And that is exactly when I gave birth to my bestiary: a giraffe watching Aaron’s plane get lost in the skies… This giraffe was the one who had planted the seed of a noble idea in my eyes. A seed that has grown ever since. That seed is now the extension of my hands: it takes the form of a dark and broad thought like the idea of the giraffe itself. The giraffe to me is a noble idea that stretches out on its expansive side towards the horizon where the wind gusts in its damp eyes. His presence secures my future.
Later, when my son Vincent was born, he became for me the keeper of these imaginary animals and his look at my work confirmed the validity of their existence in my life…
- From Iran to Montreal: a summary
It is the story of a line I drew and still draw. The line which has become an artery. It is also a story of passage from an adventure to a pictorial silence where I project myself into an endless space in which I can invent the one that inhabits me. Here, the state of the astonished beast exodus from the darkness of the cosmos to cross the borders of the surface to reach the bottom of the veins of the earth. My work is an eternal movement towards the human beast and the human beast.
- The black that covers your canvases seems to gradually disappear, in favor of the development of the bestiary: what is developing? Is the framework widening?
With me, black does not cover the canvas, it becomes it. In other words, black is the state of my work. It is in the dark that I seek to see, and what you see is the state of things I see. What you call the frame is indeed the environment of the image, or its habitat. The image lives its own body. Since the black is the state of my work, it does not disappear, it is the painting itself. The disappearance of black seen in my last series is linked to the growth of the image and its surroundings. Indeed, it is the image or what you call the bestiary that has covered the darkness. In the dark, I blacken, and the dark ignites. And the golden wefts advance to escape from the dark space. Black is the horizon of my work and of my being.
COULÉE VERTICALE par Bahman Sadighi
Né linaire-coulant, Khosro pense début et large. Il occupe la vie de la forme et de la couleur, ainsi que celle des lignures qui tentent de fermer les marges de la masse. Comme si quelque chose devait être saisi, pris dans le centre qui lui échappe sans relâche et s’exprime sous différents corps appartenant à la fois à une nuance animalière, chimérique, botanique, humain, bref, à tout ce qui s’enracine et s’encéleste.
Le centre est toujours la dernière partie de son pinceau car il est confronté par ces espèces massive de lignures courtes qui comme des fourmis occupent et ferment le haut, le bas ou les marges de la masse.
Cette verticalité et cet enfoncement se traduisent par de multiples registres : Une main à deux jours, à deux mois d’elle, bâtit un signe, un semé, un cercle, un vissage, un vent, un cou, une gueule, à mi-chemin d’une couleur qui mousse, qui pousse vers le bas enterré mais va début, se redresse, tire le coup pour attendre ce qui, sans relâche lui échappe. La forme et le corps ainsi que sa part cachée, l’âme mettent le cap toujours sur l’insondable de cette figure qui se déguise en mille, elle est souvent antique, elle est mousseuse, elle glisse, elle est insaisissable. Ce signe instable, cette chose qui se déplace sur ses tableaux, cette chose peinte comme un crabe, sa main peint à reculons, elle né-cendre le mouvement du bas de ses tableaux. C’est un mouvement de sérénité, un mouvement qui passe au-dessus du sommeil.
Son signe est souvent rond ou une profondeur empirique. Un rond qui croit comme lumière, abritant tous les étants. Ses tableaux peuvent vous remplir ou vous vider de sens courant.
Le fond noir de ses masses indique une solidité, un peuple invisible. Celui qui est en bas ou en haut d’un signe rouge, vert, blanc, doré. Un semé à travers de la terre qui traverse le volume infini, ciblé par le silence animal qui hante nos yeux.
Sur la surface de Khosro, la trace animale est toujours associée à un message qui revient une fois encore sous forme de ‘semé’, une signature qui se dé-signe partout sur le bois.